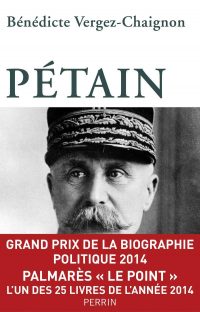
Jamais, en France, un chef militaire ne fut plus adulé ni plus détesté que Pétain. Le mérite de ce livre passionnant est de tenter de donner une explication à cet engouement et à cette détestation posthume par la restitution de la trajectoire de sa vie entière. Né en 1856, élevé par sa grand-mère, nourri des exploits en 1870 des chasseurs de Faidherbe, il a été admis quatre cent troisième sur quatre cent douze à Saint-Cyr en 1876. Officier à la carrière médiocre, colonel jusqu’en 1914, et un coup de maître le 9 mai 1916 grâce à la division marocaine qu’il commande et qui lui permet de percer le front allemand sans qu’il n’exploite cette victoire. Il prône la guerre d’usure, « l’artillerie conquiert, l’infanterie occupe ». Verdun lui vaudra son bâton de maréchal et le jugement fasciné des Français pendant vingt-cinq ans « d’homme providentiel ».
Mais les opinions militaires restent partagées. Joffre veut l’offensive, Pétain économise des hommes en relevant sans cesse les divisions éprouvées, en partageant la vie des soldats au front et en réprimant les mutineries. Dès ce moment, le caractère de ce général se dessine avec précision. Apparemment orgueilleux, il est sans ambition excessive. Il est versatile et regrette que l’armistice du 11 novembre 1918 l’ait empêché de pénétrer en Allemagne afin que celle-ci éprouve vraiment la défaite dans sa chair. Élu à l’Académie française, adorant plastronner, inaugurant à tour de bras, il devient ministre de la Guerre en 1934. Malgré les menaces, il laisse le service militaire à un an, refuse le prolongement de la ligne Maginot vers le nord, participe de loin aux décisions gouvernementales en restant plutôt silencieux. « Je hais la politique ! » Mais flagorne les puissants. Son ambassade auprès de Franco de mai 1939 à mai 1940 n’est pas brillante, mais il répète à l’envi que c’est à cause de lui que l’Espagne n’entre pas dans le conflit aux côtés des Allemands. Lors de l’invasion, il est rappelé à Paris, mais refuse d’entrer au gouvernement. Il accuse le Front populaire de la défaite et en quelques jours, grâce à l’aggiornamento des assemblées, devient le recours suprême en juin 1940, chef de l’État et non président de la République.
Le 17 juin, il fait cesser le combat et demande l’armistice, ce qui va entraîner l’emprisonnement de millions de soldats qui arrêtent de combattre et se rendent avant la signature de l’acte. Ces années seront sinistres. Car réformateur, obsédé par l’encouragement moral, antisémite avéré (il rédigera lui-même avec plus de sévérité que les Allemands les lois antijuives), xénophobe, en particulier envers les Anglais, autocrate, en conflit permanent avec Laval, il propose sans cesse d’être un collaborateur loyal et sincère à Hitler qui demande simplement à la France de rester tranquille et de pourvoir à l’entretien de ses armées. Sa confiance dans les nazis et sa servilité sont impressionnantes. Mais il demeure une icône, accepte le serment à sa personne des fonctionnaires, de la Légion des volontaires français et de la milice. Il ne fait rien pour limiter le nombre d’otages exécutés après l’assassinat d’officiers allemands. Il écrit de nombreuses fois à Hitler en l’assurant de sa sincérité, rencontre à sa demande Goering et Ribbentrop. Il propose de permettre aux troupes allemandes d’occuper les ports de Dakar, Bizerte et Alger. Il encourage la relève des travailleurs français. En un mot, il fait don de sa personne non à la France mais à la collaboration. Après quelques mois à Sigmaringen, il rentre en France. Son procès manquera l’essentiel. Très bien défendu par Jacques Isorni, il sera après quelques hésitations condamné à mort avec recommandation de grâce. Enfermé au fort du Pourtalet, il sera transféré pour des raisons sanitaires et climatiques à l’île d’Yeu où il mourra en 1951 à l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
Ce livre décisif sur Pétain met en valeur l’aveuglement des Français traumatisés par la défaite, confiant leur destin à un homme âgé de quatre-vingt-trois ans, fat sous un aspect débonnaire, ultra réactionnaire, plus catholique que les archevêques, lâche, « mort à Verdun », se dressant comme une statue vivante du musée Grévin entretenant la fiction de la permanence d’une autonomie. Il illustre non seulement l’absence totale de résistance à l’occupant, mais aussi la faillite d’un combat permanent contre la Résistance. Le jugement sévère de ce livre, très bien écrit, rejoint celui de l’Histoire. Sa lecture n’en est que plus bouleversante sur la responsabilité personnelle d’un officier général qui a blessé pour longtemps l’image de la France.