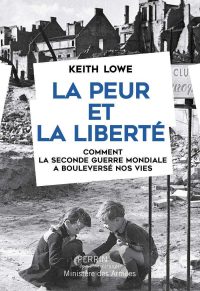
La Peur et la Liberté, l’éditeur nous en avertit, « renouvelle en profondeur notre connaissance du second xxe siècle ». Une lecture attentive ne conduit malheureusement pas à partager cet enthousiasme. Certes, le propos est foisonnant, tant il se soucie de dresser l’inventaire complet d’un legs à nul autre pareil. Mais enfin, qui ne savait déjà que le monde en 1945 était devenu absolument différent de celui de 1939 et que chacun d’entre nous vit toujours au quotidien les conséquences infinies de cette formidable climatérique que fut la Seconde Guerre mondiale ? Qui contestait que ce conflit, « d’une nature écrasante, d’une ampleur géographique sans précédent, d’une horreur incomparable », en semant partout les graines d’une aspiration nouvelle à la liberté, « valeur inestimable », et en propageant aussi les germes de nos plus grandes peurs « existentielles », provoqua des ruptures majeures, heureuses ou néfastes, qui bouleversèrent tant l’ordre du monde et des sociétés que la condition humaine elle-même ? Qui niait que la mémoire de cette catastrophe ne cesse de modeler nos existences, d’inspirer nos raisons d’être, de déterminer nos sentiments d’appartenance ? Qui, enfin, s’obstinait à ne pas admettre que depuis trois quarts de siècle le bien, la paix et la liberté n’ont pas définitivement triomphé du mal, de la guerre et de l’oppression, que les plus belles utopies comme les plus forts idéaux ne l’emportent pas toujours sur des réalités, notamment géopolitiques, plus prégnantes ?
On ajoutera qu’un livre épais de plus de six cents pages se répète beaucoup et pâtit de l’inégale valeur informative de ses chapitres, dont certains ne sont que de bons cours de terminale. On y observe aussi quelques erreurs ou approximations. Ainsi Goebbels ne fut-il pas le premier à avoir donné à la notion de « guerre totale » son sens contemporain ; ainsi de Gaulle n’était-il animé d’aucune haine vis-à-vis de l’Allemagne en 1945 ni même d’une volonté de la diaboliser. De même, l’analyse de l’actuelle crise ukrainienne semblera bien légère aux spécialistes…
Reconnaissons cependant que ces scories ne nuisent pas à la démonstration. C’est ailleurs que la critique peut et sans nul doute doit porter. La méthodologie et les partis pris (très honnêtement assumés) de l’auteur, tout autant que son texte, appellent en effet un examen scrupuleux. En choisissant d’incarner chacun des bouleversements et des mythes induits par la Seconde Guerre mondiale avec l’histoire d’un homme ou d’une femme lui ayant survécu, Keith Lowe recourt à plusieurs registres explicatifs dont il assure adroitement la mise en cohérence. Rappeler que les souvenirs des individus, leurs expériences passées, ne concernent pas qu’eux-mêmes, mais l’ensemble de l’humanité, que de la sorte la partie se reflète dans le tout et vice versa, n’est pas seulement postuler qu’au fond l’écriture de l’histoire exige une tractation permanente entre le singulier et l’universel, entre l’événement et le sujet, entre le présent et le passé. La micro histoire a convaincu l’historien que la biographie peut aider à rendre compte que les faits et gestes d’un individu dont le destin n’est pas inéluctable se développent selon une stratégie qui lui est propre et introduit sa situation particulière dans l’universel. Ces propositions s’accommodent fort bien de celles de l’existentialisme (en l’occurrence celui de Sartre) fréquemment convoquées elles aussi pour interpréter l’« état d’esprit de l’après-guerre ».
Keith Lowe revient chaque fois qu’il le juge nécessaire sur cette idée que des conclusions universelles peuvent être tirées de l’expérience de l’individu « condamné à être libre », « à s’inventer », investi de la responsabilité de son seul destin pour survivre. Il considère aussi que l’analyse psychanalytique appliquée aux comportements et aux représentations des individus peut être étendue aux groupes, sociaux ou nationaux. Admettre que les inconscients individuels et collectifs fonctionnent selon les mêmes modes l’invite à soutenir que les syndromes de stress post traumatique qui dominaient nos aïeux atteignirent aussi les collectivités nationales auxquelles ils appartenaient, forgeant des mythologies qui expliquent toujours nos propres peurs, refus et préjugés.
Lowe n’est certes pas le premier à tirer profit des relations, anciennes et complexes, entre l’histoire et la psychanalyse. Les deux disciplines, par exemple, s’accordent sur « le présent comme passé cristallisé ». Mais il y procède sans trop de précautions. La transposition psychanalytique dans le champ de l’histoire, fort en vogue auprès des fondateurs de l’histoire des « mentalités », pose tout de même de redoutables questions. Le point de vue psychanalytique peut sembler réducteur à quiconque se veut attentif à ne pas occulter le point de vue historique et collectif du devenir social. Peut-on élaborer des généralisations collectives probantes à partir d’extrapolations sur l’inconscient individuel ? Le débat est toujours ouvert. On peut comprendre que Keith Lowe ne se soucie pas d’étayer une posture épistémologique implicite, mais on regrette vivement qu’il s’en remette parfois à des considérations de comptoir sur « la nature humaine ».
Les témoignages sur lesquels se fonde la démonstration sont pour l’essentiel issus des mondes anglo-saxons et japonais. Quant aux références historiographiques, elles composent une bibliographie à 90 % anglo-américaine ou non francophone. Pour autant, Keith Lowe s’autorise à appliquer sans nuances les mêmes schémas interprétatifs à la scène mondiale dans son ensemble. Dès lors, la guerre d’Algérie, expédiée en quelques lignes, est soumise à la même lecture que l’accès à l’indépendance du Kenya, traitée en une quinzaine de pages. L’évocation de l’essor des planifications économiques et sociales en Occident ne dit pas un mot du programme du cnr, « Les jours heureux », qui rebâtit pourtant le contrat social d’un pays durement soumis à une occupation étrangère, à ce titre très différent du Royaume-Uni de Beveridge. Le chapitre dédié à la construction européenne, parmi les plus ternes et décevants du livre, ne met pas en valeur le rôle moteur de la France. Enfin, Keith Lowe postule à propos de l’Afrique (mais encore de l’Asie, de l’Amérique latine et aussi de l’Europe !) qu’une nation n’est rien d’autre qu’une « communauté imaginaire ». Voilà tout de même qui mériterait plus de précisions ! Sans en appeler nécessairement aux conceptions essentialistes si importantes dans la culture allemande, peut-on négliger absolument la tradition contractuelle retenue en France depuis Taine ? Surtout, peut-on dire sans autre forme de procès que l’Afrique vit à partir des années 1950 l’émergence d’une trentaine « d’États-nations » ?
Keith Lowe légitime ses choix en posant la question de la vérité en histoire. L’« absolue » vérité, concède-t-il, n’est qu’imparfaitement reflétée par la mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective. Il faut, pour s’en approcher « au plus près », y ajouter le travail de l’historien qui parachève l’interaction entre les récits individuel et collectif. La question de l’« objectivité » du texte de l’historien ne peut évidemment pas être aussi simplement résolue. À s’en tenir à la conception retenue, il faut alors vérifier que toutes les mémoires, dans leur totale diversité, ou du moins les mémoires représentatives de la somme des diversités, ont bien été assignées à comparaître. Or, cela n’est pas le cas. Comment alors ne pas soupçonner le jugement d’être contestable sinon faux, bien que les références soient exactes ? Qu’est-ce d’ailleurs que l’« absolue » vérité ? La question du jugement est au cœur de l’histoire et chaque historien peut et sans aucun doute doit, comme le fait Keith Lowe, justifier sa volonté de faire connaître et comprendre par ses propres interrogations, ses choix de méthode et d’écriture, pour tout dire son engagement. « Nous les historiens sommes des êtres humains traversés d’émotions comme tout le monde », écrit-il. La difficulté n’est pas qu’il privilégie des orientations et produise des jugements de valeur ou de réalité : c’est là son droit. Mais son lecteur peut lui reprocher sa méthode et ses approches, revendiquer à son tour sa liberté de juger, voire de réfuter cette « part de vérité » qui lui est proposée. Surtout, s’exposer à la tentation de trouver sinon « une » vérité du moins un « sens » à l’histoire est toujours pour l’historien un exercice des plus périlleux, surtout s’il s’en remet incidemment à de vieux modèles interprétatifs très occidentaux et semble-t-il passablement usés. L’histoire est-elle vraiment « autant alimentée par les émotions collectives que par la marche rationnelle vers le progrès » ? Comment le penser ? Comment y croire ?