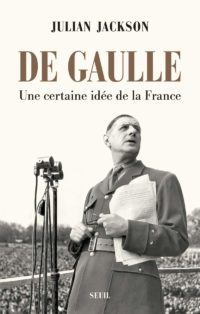
L’imposante biographie que nous propose Julian Jackson (près de mille pages d’un texte dru) domine, pour ne pas dire écrase, l’abondante, et très inégale, littérature que le cinquantième anniversaire de la disparition du général de Gaulle n’a pas manqué de produire. Elle en réduit aussi beaucoup d’autres précédemment publiées, parfois de qualité mais souvent embourbées dans les passions françaises, au statut de simples références bibliographiques. Son propos n’est pas de contribuer à ce quasi œcuménisme mémoriel – assez étonnant si l’on veut bien s’y attarder – qui semble aujourd’hui affranchir le « grand homme de la France » de l’histoire. C’est précisément cette volonté déclarée de donner à comprendre raisonnablement qui souligne l’intérêt de ce livre majeur.
Julian Jackson dispose de solides atouts pour mener sa tâche colossale d’une aussi éclatante façon. Le premier d’entre eux, ce n’est pas le moindre, est d’être tout à la fois Anglais et francophile. Il ne partage donc pas les préjugés, le plus souvent défavorables, de ses compatriotes ; en même temps, son intelligence des mentalités, des sensibilités, de la culture politique françaises lui permet d’entrer pleinement dans la compréhension de son sujet en se déjouant des idées reçues et des vérités taboues. Ce sont là d’heureuses qualités, suffisantes pour s’affranchir des servitudes d’une approche purement gallocentrique, nécessaires aussi pour ne pas se poser en procureur ou en avocat, ou bien, si l’on préfère, pour vouloir tenir les deux rôles à la fois et assumer ce que René Rémond appelait si élégamment le « don de sympathie » de l’historien. De fait, si Julian Jackson ne dissimule pas l’admiration que le chef de la France libre comme le président de la Ve République, le premier sans doute plus que le second, lui inspire à certains moments, l’expression de ce sentiment n’esquisse aucune hagiographie. Son jugement d’historien, toujours fondé sur l’évaluation rationnelle des faits, délivre parfois des conclusions sévères. D’ailleurs, la reconnaissance du statut historique exceptionnel d’un personnage pour tout dire incomparable ne lui interdit pas de s’attarder sur la psychologie peu flatteuse de l’homme public afin de décrire sans fard des traits de caractère qui l’ont toujours rendu odieux, même auprès de ses premiers apôtres. Quelles que soient l’époque et les circonstances, de Gaulle affiche en effet vis-à-vis de son entourage comme de ses contemporains une absence d’empathie déconcertante, voire quelque peu effrayante. On peut concevoir qu’il ait fait preuve de dureté envers ceux qui l’accompagnèrent pourtant avec abnégation, lui-même ayant sans faillir consenti à tant de sacrifices, mais cette attitude ne manque pas de troubler lorsque, par exemple, elle malmène et blesse tant de Résistants à la Libération. La mauvaise foi qu’il affiche sans état d’âme, son ingratitude et, plus encore, son incapacité proprement « physique » (le mot est de Julian Jackson) à reconnaître qu’il s’est trompé, son refus d’admettre qu’il puisse être redevable à quelqu’un ont toujours dérouté, et souvent exaspéré, les témoins de sa longue carrière. Ces travers, qui ne sont pas minces, affectent inévitablement le comportement politique du « Général », qu’une claire conscience de son génie habite en toutes circonstances et pousse à maintenir avec son entourage une distance glaciale qui déstabilise jusqu’aux rares élus auxquels il accorde sa confiance. De même, le débat collectif n’est pas son fort et la contradiction lui est insupportable. Les entretiens et les audiences qu’il accorde ne sont généralement que les occasions de longs monologues qui empêchent de vrais échanges. Lui-même l’avoue : « On ne discute pas avec le général de Gaulle. » Quoique peu disponible pour entendre, il sait néanmoins écouter… sans jamais le reconnaître.
Julian Jackson use encore avec une habileté extrême des règles méthodologiques et des techniques narratives qui fondent l’objectivation de la démarche de l’historien. Tout biographe sait que son récit ne peut atteindre la dimension réflexive qui le justifie et produire cet « effet de vécu » qui ajoute à sa compréhension sans interroger une action humaine dotée de sens, et rendre accessibles au lecteur les arcanes des rapports complexes entre les logiques individuelles et les logiques structurelles. À cette fin, il lui faut notamment tracer la piste d’un vrai savoir dans l’enchevêtrement, en l’occurrence extrême, des sources, des mémoires, des témoignages et des travaux historiques, parmi lesquels plusieurs thèses récentes et non publiées. Julian Jackson a lu l’ensemble de la documentation adéquate et a soumis continûment cette masse énorme d’informations à une minutieuse analyse critique. Les circonstances l’autorisent d’ailleurs à le faire d’une façon novatrice : la combinaison des archives historiques anglaises et américaines avec les archives présidentielles de De Gaulle, récemment rendues accessibles au public, et encore cette mise en relation, arachnéenne, des diverses versions (rédigées, prononcées, publiées) de textes majeurs extraits des Mémoires de guerre, des Mémoires d’espoir, et des Discours et messages. Cet effort considérable n’est pas vain. La preuve est administrée que, dès le début, de Gaulle se soucie de réécrire, d’une manière aussi magistrale que partiale, son histoire et, par là, celle de la France, qu’il conçoit toutes deux comme des exempla propres à édifier la postérité. Ensuite, cette approche fouillée des sources permet de contextualiser dans le détail les grands accomplissements gaulliens. Dès lors, à travers le prisme biographique, un demi-siècle de l’histoire de France peut être pensé (et repensé) et des catégories chères à l’historien sont mises à l’épreuve. Par exemple, si l’on convient qu’il n’y a évidemment pas d’histoire sans acteur, il reste toujours difficile d’évaluer précisément la capacité d’action de l’individu dans l’histoire et plus encore sa marge d’autonomie. Or, comment ne pas conclure ici que l’événement crée de Gaulle autant que de Gaulle crée l’événement ? Qui plus est, chaque moment de la tragédie nationale au xxe siècle se confond avec la tragédie d’un destin individuel hors norme. Dire que le tragique institue l’action du général de Gaulle n’est pas trop forcer le trait, est rappeler qu’une fois la tourmente surmontée, il revient à l’homme providentiel de faire la démonstration qu’il demeure indispensable. En ce sens, 1940 appelle 1946, comme 1958 appelle 1969.
L’ampleur de ce livre empêche sa recension d’en proposer l’analyse exhaustive ou même la synthèse. C’est pourquoi on se bornera, arbitrairement, à quelques traits saillants qui, sans nul doute, appelleront bien des réactions. Il faut d’abord convenir que Julian Jackson pénètre au cœur de son sujet sans être abusé par son apparence granitique. Il n’entend pas davantage lui imposer une cohérence exclusive, allant jusqu’à affirmer dès l’introduction que si de Gaulle eut toute sa vie une certaine idée de la France, « ce ne fut pas toujours la même ! » (p. 30). La formule ne relève pas d’un simple exercice de style. La sacralisation de l’État et l’obsession de l’indépendance nationale déterminent si profondément de Gaulle, lui inspirant des pages parmi les plus belles de la littérature française, qu’elles semblent transcender son action et l’affranchir de toute analyse rationnelle. Certes, il n’en est rien, mais il demeure délicat d’en dresser une analyse assez subtile pour intégrer l’ensemble de ses nuances. Julian Jackson s’essaie à plusieurs reprises de brosser le portrait moral et politique de l’homme illustre, notamment dans ce passage, vrai morceau de bravoure, qui vaut d’être cité : « La tension entre la modération et l’hubris, la raison et le sentiment, le classicisme et le romantisme, le calcul et la provocation, la crise et le geste spectaculaire, Corneille et Chateaubriand, Descartes et Bergson, est un trait constant de la carrière de De Gaulle » (p. 841). On peut ajouter à cette large palette que de Gaulle fut tout à la fois un militaire, plus attentif à la stratégie qu’à la tactique, un intellectuel féru de littérature et de sciences humaines, un penseur théorique de la politique, que sa vaste culture autant que son expérience convainquirent que l’histoire et la géographie priment à plus ou moins long terme sur les fractures idéologiques et géopolitiques.
Il use de concepts suggestifs, tout particulièrement la « grandeur », dont il se garde de fournir une définition précise, si bien que leurs applications concrètes demeurent fluctuantes et évolutives. Lors des moments difficiles, les consignes qu’il délivre à ses conseillers ou à ses ministres sont assez cryptiques pour souffrir diverses interprétations, plongeant les malheureux dans l’angoisse de se tromper. Son goût du secret et de la dissimulation le rend imprévisible en même temps qu’il protège sa liberté d’action. Ses volte-face, que rien ne laisse présager, surprennent les observateurs les plus attentifs. Quant à son exaltation naturelle, elle exaspère des générations d’hommes d’État anglo-saxons et allemands. Pour autant, il fait preuve d’une grande clairvoyance et d’un pragmatisme avéré et sait, longtemps, jusqu’où ne pas aller. Il le démontre à de multiples reprises entre 1939 et 1945, et plus particulièrement dans ses relations avec Churchill et Roosevelt, mais aussi entre 1958 et 1965, avant qu’il ne perde progressivement la main, tant en politique intérieure qu’en politique étrangère. La théorie de l’action qu’il a reçue de Bergson et la conviction, inspirée par la lecture de Gustave Le Bon, que l’irrationalité des foules demeure pour l’homme d’État une contingence majeure lui rappellent opportunément qu’« il n’y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités » (discours de juin 1960, cité p. 706). C’est donc à l’épreuve des faits qu’il forge son opinion et décide, seul, de son action.
On trouvera dans les deux chapitres consacrés à la guerre d’Algérie, parmi les plus forts du livre, une excellente démonstration par l’exemple de cette philosophie politique. Julian Jackson expose comment les évènements de mai 1958 permettent à de Gaulle de réaliser un nouveau 18 Brumaire qu’il a résolument encouragé. La comparaison avec Bonaparte n’est pas innocente. En 1958 comme en 1799, le coup d’État ne peut avoir lieu qu’avec le soutien de l’armée. De même, il est légalisé sans difficulté parce que les élites du pays ont perdu confiance dans le régime en place pour résoudre une crise nationale existentielle. Cependant, la guerre dure encore quatre ans, de Gaulle, prisonnier de ses engagements initiaux et balloté par les événements, ne se résignant pas à accepter la solution que les faits ne cessent de dicter. L’habileté politique du fln finit par lui imposer un revirement réaliste mais trop tardif pour lui laisser la moindre marge de manœuvre lors des ultimes négociations. Néanmoins, c’est sans état d’âme qu’il renonce alors à sauvegarder tout ce qui lui paraissait jusque-là essentiel de sauvegarder. Finalement, sa seule réussite n’est pas d’avoir, comme il l’écrit, « accordé » à l’Algérie une indépendance qui, en vérité, lui a été arrachée, mais d’avoir convaincu l’opinion publique qu’il s’agissait de la seule issue conforme à l’intérêt national.
Ce réalisme politique, assorti aux exigences supérieures de la raison d’État, l’a précédemment conduit, au terme d’un cheminement marqué de peu d’enthousiasme, à accepter l’idée de la république, qu’il n’aime pas, comme forme de gouvernement pour la France. Comme Maurras, de Gaulle nourrit la nostalgie de la tradition monarchique et pense que la Révolution n’est pas le moment le plus glorieux de l’histoire de France mais, contrairement à lui, il sait le retour de la monarchie impossible. Chef de la France libre, il tarde à républicaniser son discours. Il s’y résout par nécessité, afin de bénéficier de la reconnaissance de la Résistance intérieure qui lui permet de s’imposer aux Anglo-Américains. Ce choix, mûrement réfléchi, l’engage définitivement. Son génie politique le conduit, comme d’habitude, à dépasser les circonstances immédiates de sa résolution. Désormais seul dépositaire à ses yeux de la continuité républicaine, il refuse, tout à fait logiquement, de proclamer en août 1944 une république « qui n’a jamais cessé d’être ».
Toutefois, la République appelée à devenir le cadre institutionnel de ce qu’il est convenu d’appeler le « gaullisme » doit obéir aux conceptions particulières qu’il s’en fait. Prenant parfois le contre-pied de beaucoup de constitutionalistes français, Julian Jackson démontre que la Constitution de 1959, mi-présidentielle, mi-parlementaire, ne correspondant à aucun modèle antérieur, témoigne là encore, malgré le déséquilibre instauré entre l’exécutif et le législatif, de quelques compromis avec les héritiers de la tradition républicaine attachés au régime parlementaire (avant qu’il ne les affronte sans aucun esprit de concession cette fois avec la réforme de 1962). Cependant, de Gaulle est par trop convaincu, et depuis trop longtemps, d’incarner l’État et la France pour ne pas considérer que cette légitimité unique l’autorise à interpréter à sa convenance une Constitution et, par là, lui commande d’émanciper le fonctionnement de l’exécutif du strict respect de certains des principes constitutionnels. Dans les faits, le centre du pouvoir est situé d’emblée à l’Élysée et non pas à Matignon. Le premier président de la Ve République gouverne, et il gouverne seul, définitivement pénétré du sentiment que l’exercice du pouvoir se confond avec l’autorité charismatique du chef de l’État. Cette mystique lui insuffle une incroyable énergie ; elle l’entretient aussi dans une « utopie unanimiste » (l’expression est de Georges Pompidou) et le pousse à entretenir une relation directe avec le peuple, c’est-à-dire à recourir chaque fois qu’il le juge nécessaire aux ressources de la démocratie plébiscitaire. Julian Jackson pointe dans cette volonté permanente de transcender les clivages politiques traditionnels une dimension bonapartiste du « gaullisme ». En définitive, de Gaulle cherche à concilier la tradition révolutionnaire avec la tradition monarchique, entendons la gauche avec l’autorité, la droite avec la démocratie, la gauche et la droite avec la nation. Cette volonté n’en fait évidemment pas un dictateur, mais elle contribue à expliquer son goût pour un style autoritaire du pouvoir et donne à son régime les traits d’une monarchie républicaine. Elle perturbe aussi sa perception des rapports de force politiques – l’élection présidentielle de 1965 et les législatives de 1967 en apportent des indices notoires – comme elle expose sa conduite à de périlleuses contradictions. Les réalités de la démocratie parlementaire demeurent incontournables ; il n’est pas de gouvernement possible et stable sans une majorité à l’Assemblée nationale. Tout en affectant de se tenir au-dessus de la mêlée des partis, le Général, qui a appris depuis longtemps à « faire de la politique », n’hésite pas à quitter ses hauteurs olympiennes. Il pèse de tout son poids sur chaque scrutin, exploitant toutes les ressources de communication que lui offre ce nouveau média qu’est la télévision, dictant au gouvernement des « éléments de langage » intangibles, décidant dans le détail des listes de candidats, s’informant sur chaque circonscription.
Aucune biographie de Charles de Gaulle ne peut prétendre être définitive ; le sujet est trop gigantesque pour le permettre. Toutefois, le travail de Julian Jackson opposera, n’en doutons pas, une belle résistance au temps. Comment ne pas remarquer enfin que, par l’effet d’une ironie dont témoigne parfois l’histoire en train de se faire, ce livre paraît à l’heure du Brexit.