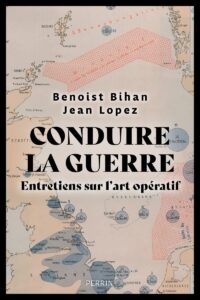
Qu’est-ce que l’art opératif dans la guerre ? La notion fait l’objet de nombreux débats, y compris sur sa définition. Écrit à deux mains par Jean Lopez, directeur de la rédaction du magazine Guerre & Histoire et auteur de nombreux ouvrages d’histoire militaire, et Benoist Bihan, chercheur en études stratégiques et auteur de La Guerre. La penser et la faire (2020), ce livre prend la forme originale d’un dialogue de trois cent cinquante-six questions de Jean Lopez et autant de réponses de Benoist Bihan. Un choix qui peut dérouter certains lecteurs, voire ralentir la bonne compréhension des notions évoquées. Pour autant, la lecture n’en est pas désagréable. Les deux auteurs disposent en effet d’une très grande culture historique et militaire, ce qui permet d’enchaîner avec fluidité des questions et des réponses très pertinentes. De plus, de courts résumés à la fin de chaque partie recadrent la réflexion.
Structuré en sept chapitres, l’ouvrage s’ouvre avec la définition du cadre d’étude et en exposant « le divorce millénaire entre la tactique et la stratégie » consacré en 1918. Dès l’Antiquité, et malgré quelques éclipses comme à l’époque napoléonienne, « la violence de guerre ne sert que rarement les buts assignés par le stratège ». Cette partie inaugurale est également l’occasion de poser les définitions des notions clés. Les deuxième et troisième chapitres sont le cœur de cet opus. Ils abordent la théorie développée par Alexandre Svetchine (1878-1938) et les apports de son ouvrage majeur Strategiia (1927). Général d’artillerie du tsar rallié à l’Armée rouge, il fut également professeur de stratégie. Disciple du Prussien Carl von Clausewitz, il va en quelque sorte faire une synthèse de sa pensée avec les théories politiques de Marx. Svetchine développe un outil, « l’art opératif », que Benoist Bihan décrit comme le harnachement qui permet au cavalier stratège de guider le combattant dans la bonne direction. En effet, le but de l’art opératif est d’offrir les moyens pour mener les combats favorablement à la guerre, « d’organiser l’activité militaire en ”opérations”, sur la base de buts fixés, eux, par la stratégie ». Pour Bihan, ce sont bien les Soviétiques qui sont à l’origine de cette percée conceptuelle, et en particulier Svetchine.
Les auteurs abordent ensuite la question de l’application de l’art opératif par les Soviétiques, en s’attachant notamment aux notions d’opérations et de bataille dans la profondeur ainsi qu’aux apports théoriques de Triandafillov et de Toukhatchevski. Après un chapitre sur la question des caractéristiques de l’art opératif sur mer ou dans les airs, ils s’attellent à expliciter ce qu’ils nomment « la crise de la stratégie » post-1945 alors que « la prégnance du fait nucléaire a pour effet de découpler la politique et la stratégie et de renvoyer cette dernière vers la tactique, elle-même réduite à la technique ». Enfin est posée la question de l’intégration par les Occidentaux, Américains et Français en particulier, de l’art opératif tel que théorisé par les Soviétiques. Pour les auteurs, la réponse est très largement négative : la greffe n’a pas pris, comme le montrent en particulier les guerres d’Irak et d’Afghanistan.
Cet ouvrage, peut-être un peu trop affirmatif et radical dans sa thèse d’un modèle « pur » d’art opératif soviétique, n’en est pas moins passionnant. Il permet en particulier de se reposer une question toujours centrale : comment l’outil militaire contribue-t-il à atteindre des buts politiques ? Exigeante, sa lecture demande de solides connaissances en histoire militaire du xxe siècle et en stratégie. Mais ouvre une porte sur des théoriciens soviétiques méconnus, permet de creuser le concept d’art opératif et offre de très nombreuses pistes de réflexion sur la façon dont on doit conduire un conflit.