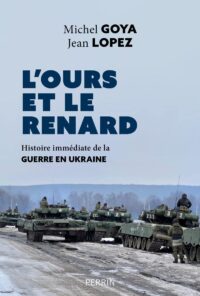
« Mettre de l’ordre dans la masse d’informations relatives aux combats déversée sur nos têtes depuis le 24 février 2022 », c’est le défi que relèvent avec brio Michel Goya, colonel (er) des troupes de marine, historien et consultant pour la télévision depuis le début du conflit, et Jean Lopez, rédacteur en chef du magazine Guerre et Histoire, également historien, spécialiste en particulier du front de l’Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Prenant la forme d’un dialogue très efficace, cet essai suit un plan chronologique. L’introduction revient donc d’abord sur les « Racines de la guerre » : Première et Seconde Guerre mondiale, premier Maidan (1990) puis deux autres (2004 et 2013), invasion de la Crimée (« une promenade militaire qui jouera beaucoup dans l’hubris de 2022 ») et guerre du Donbass en 2014-2015. Le chapitre inaugural, « Deux armées en mutation », est consacré à un point de situation au moment de l’invasion. Il détaille notamment la transformation de l’armée russe, restée « entre deux eaux », n’étant plus l’immense machine à mobiliser qu’elle a pu être (elle ne dispose « que » de cent vingt mille hommes pour son offensive) tout en n’étant pas encore totalement professionnalisée. L’armée ukrainienne, elle, a « muté en silence », surprenant ainsi les observateurs quant à sa solidité. Le deuxième chapitre décrit l’échec de l’offensive russe, qui se voulait « éclair », avec ses deux objectifs vraisemblables qui ne sont pas atteints : prendre Kiev et encercler les forces ukrainiennes dans le Donbass. De nombreux épisodes de ces premières semaines de combat sont décryptés : tentative de saisie des aéroports, embuscade de Brovary, « tir aux pigeons » sur un embouteillage de soixante-quatre kilomètres de long, « bidonnage » de l’île aux serpents… Dans le troisième chapitre, les auteurs développent les opérations menées au Donbass à partir de fin mars, à la suite de l’échec de l’offensive en direction de Kiev. Malgré douze à treize mille projectiles tirés chaque jour par les Russes, le terrain qu’ils gagnent en trois mois est faible. Cette section est également l’occasion d’aborder la question de l’aide occidentale à l’Ukraine, aide qui est pour beaucoup dans le retournement du rapport de force à partir de juin, en particulier suite aux livraisons de pièces d’artillerie. Le quatrième chapitre analyse la contre-offensive ukrainienne en revenant notamment sur la ruse de Kherson, la percée du 6 septembre dans la région d’Andriivka ou la mobilisation de trois cent mille hommes côté russe. Des événements annexes font également l’objet d’intéressants développements, comme l’attentat contre le pont de Kertch et le sabotage des gazoducs Nordstream. Le cinquième chapitre est dédié à l’échec de la plus grande campagne de missiles de l’histoire ainsi qu’aux opérations cyber, tirant notamment cette conclusion quant à ces dernières : « L’arme cyber russe est suffisante pour des opérations clandestines de piratage ou d’intrusion, mais elle est mal taillée pour des opérations coordonnées de grande ampleur et de longue durée. » Enfin, dans l’ultime chapitre, les deux auteurs font un point de situation à la mi-mars 2023, comparant les forces des deux armées et analysant les possibilités d’offensives pour l’armée ukrainienne.