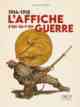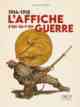1. Éditeur
Le site est publié par :
La revue Inflexions
Case 09 – 1 place Joffre
75700 PARIS SP 07
Hébergement :
Scaleway
N° TVA : FR 35 433115904
Siège social : 8 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris
Pour contacter cet hébergeur : https://console.scaleway.com/
2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés :
L’utilisation du site inflexions.net implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site inflexions.net sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par inflexions.net, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Le site inflexions.net, est mis à jour régulièrement par la revue Inflexions. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.
3. Description des services fournis :
Le site inflexions.net a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités et des publication de la revue Inflexions.
La revue Inflexions s’efforce de fournir sur le site inflexions.net des informations aussi précises que possible.
Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées sur le site inflexions.net sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site inflexions.net ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
4. Propriété intellectuelle et contrefaçons :
La revue Inflexions est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, vidéo, logos, icônes, sons.
Cédric Scandella est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur le logiciel et le design du site.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de la revue Inflexions.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
5. Gestion des données personnelles :
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
À l'occasion de l'utilisation du site inflexions.net, peuvent êtres recueillies : l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site inflexions.net, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.
En tout état de cause la revue Inflexions ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site inflexions.net. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site inflexions.net l’obligation ou non de fournir ces informations.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site inflexions.net n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du rachat de la revue Inflexions et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site inflexions.net.
Le site n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations personnelles.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
6. Liens hypertextes et cookies :
Le site inflexions.net contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de la revue Inflexions. Cependant, la revue Inflexions n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.
La navigation sur le site inflexions.net n’est pas susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur pour refuser l’installation des cookies.
7. Droit applicable et attribution de juridiction :
Tout litige en relation avec l’utilisation du site inflexions.net est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.